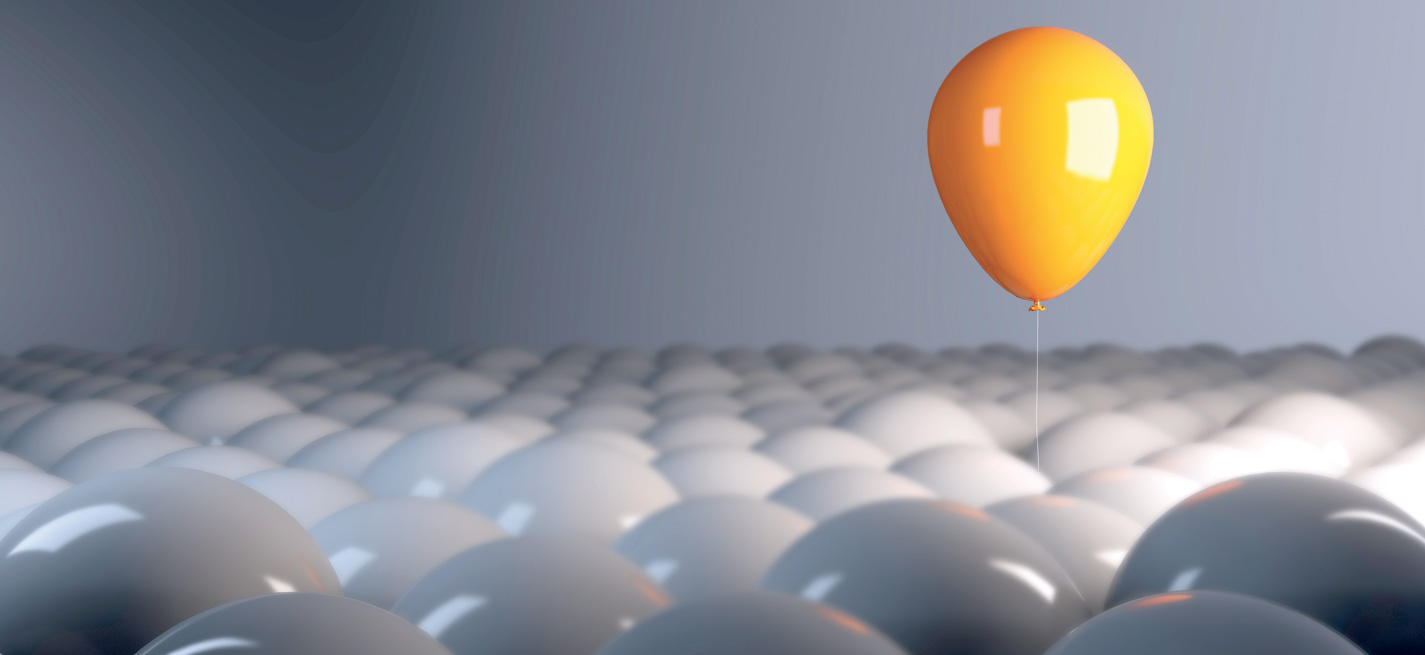L’innovation est la clé de la compétitivité des laboratoires. Depuis le premier vaccin contre la parvovirose canine lancé en 1981, d’autres produits sont venus étoffer l’arsenal thérapeutique vétérinaire. L’industrie peut-elle encore proposer de nouveaux produits dits “révolutionnaires” ? Elle a plusieurs cordes à son arc.
« Chaque médicament est une innovation », écrivait le philosophe Francis Bacon. Pour répondre aux besoins médicaux, le chercheur est en première ligne. Il cherche, il trouve. Il est pourtant confronté aux caprices du temps, nécessaire au succès de son entreprise. Ce long processus est indispensable pour garantir l’efficacité, la sécurité et la qualité d’un médicament vétérinaire. Comme en santé humaine, la recherche et l’innovation sont des termes omniprésents dans la communication des laboratoires. Alors, innove ou n’innove pas ? Les industriels de la santé animale veulent en tout cas anticiper les nouveaux besoins. L’Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses-ANMV) indiquait dans son rapport d’activité 2017 que 85 autorisations de mises sur le marché (AMM) ont été délivrées. En décembre dernier, l’Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie (Afvac) remettait les premiers prix de l’innovation vétérinaire avec le soutien du Syndicat de l’industrie du médicament et réactif vétérinaires (SIMV). L’Afvac indiquait alors dans son communiqué de presse que l’objectif de cette démarche « est de valoriser les innovations vétérinaires dans le domaine des animaux de compagnie et de mettre le vétérinaire au centre de cette innovation, toute innovation se définissant comme une valeur ajoutée perçue par le vétérinaire et le client. »
Premiers vaccins au XIXe siècle
« Le secteur de la santé animale est responsable d’un flot continu d’innovations », indique Animalhealth Europe. Les premiers vaccins contre le charbon et la rage ont été mis au point à la fin du XIXe siècle. Une protection contre d’autres maladies courantes, telles que la fièvre aphteuse et la brucellose, a suivi au début des années 1930. Au cours des 20 à 30 dernières années, de nouveaux progrès ont été constatés : vaccins, analgésiques, anesthésiques et traitements anticancéreux améliorés. Selon Animalhealth Europe, les industriels de la santé animale sont déterminés à investir dans la recherche ; jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires. « Cependant, au cours des dernières années, les investissements dans la recherche en Europe ont légèrement diminué, se situant actuellement à 8 % en moyenne », regrette l’association européenne. Mais, l’industrie contribue à des programmes de recherche et développement (R & D), tels que Star-Idaz, l’alliance stratégique mondiale pour la coordination de la recherche sur les principales maladies infectieuses des animaux et des zoonoses. « L’industrie est également en train d’identifier et de combler les lacunes en matière de recherche concernant plus de 30 maladies ciblées et émergentes grâce au développement de vaccins, de diagnostics et de traitements. Elle a également contribué au financement de Discontools, une initiative visant à améliorer et à accélérer le développement de nouveaux produits de diagnostic, de vaccins et de produits pharmaceutiques pour les maladies animales », indique Animalhealth Europe.
Retrouvez l'intégralité de cet article en pages 40-46 de La Semaine Vétérinaire n° 1796.