DOSSIER
Auteur(s) : Par Tanit Halfon
Depuis presque vingt ans, le modèle des centres hospitaliers vétérinaires (CHV) s’est progressivement développé, en se positionnant dans la médecine de pointe, qui va de pair avec un plateau technique adapté et une amplitude d’ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tel que défini dans leur cahier des charges1. Actuellement, il existe 14 CHV, dont trois équins (voir carte). Dans le contexte actuel, où l’écosystème vétérinaire évolue fortement en matière d’organisation et d’économie, quel est l’avenir de ce modèle de soins ? Selon l’avis des professionnels interrogés dans ce dossier, il fonctionne, et la demande croissante en soins vétérinaires spécialisés pousse logiquement à la création de nouvelles structures. « Les CHV sont devenus indispensables dans le paysage français, tant pour la permanence et la continuité des soins que pour la garantie des moyens mis en œuvre dans les soins, l’essor de la formation postuniversitaire et de la spécialisation, défend Éric Bomassi (A 95), président du Syndicat national des CHV de France, spécialiste en médecine interne des animaux de compagnie et chef du service de cardiologie au CHV Les Cordeliers, à Meaux (Seine-et-Marne). Pour les détenteurs d’animaux, ce modèle fait écho aux hôpitaux en médecine humaine, ce qui offre une bonne visibilité et une compréhension de nos structures. » « Le CHV est un agrégateur de compétences. Les spécialistes ont envie de travailler ensemble, au sein d’une équipe multidisciplinaire, pour proposer une médecine d’excellence », explique Dimitri Leperlier (A 05), spécialiste en chirurgie des animaux de compagnie au CHV Pommery, à Reims (Marne). Adeline Linsart (N 04), praticienne exclusive en médecine des nouveaux animaux de compagnie au CHV Saint-Martin, à Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie), abonde dans le même sens : « L’atout du CHV, c’est vraiment l’équipe. Dans nos structures, un animal n’est jamais guéri par une seule personne. Conserver une équipe soudée et compétente, qu’on a formée, est un vrai enjeu pour nos établissements. »
Des structures en croissance
Ces équipes ont grossi de manière exponentielle au fil des ans, et tout particulièrement celles des CHV pour petits animaux de compagnie. Dans celui de Saint-Martin par exemple, il y a aujourd’hui 90 salariés, dont une petite quarantaine de vétérinaires et sept spécialistes. En 2008, lors de la création de la structure, qui a la particularité d’être un CHV depuis son ouverture, ils étaient cinq. Les deux plus vieux CHV de France, Fregis, à Arcueil (Val-de-Marne), et Atlantia, à Nantes (Loire-Atlantique), comptent actuellement respectivement des équipes de 130 – dont 60 vétérinaires et 19 spécialistes –, et 120 personnes, – dont 60 vétérinaires et 15 spécialistes. « Tous les CHV qui se sont construits ces dix dernières années sont le fait de vétérinaires passionnés, désireux de développer un haut niveau scientifique. Les fondateurs n’étaient, pour la plupart, pas spécialistes, mais ils ont su s’entourer ensuite de spécialistes européens et français », détaille Isabelle Testault (N 92), spécialiste en médecine interne au CHV de Nantes. À ce jour, « Atlantia est devenue une véritable petite et moyenne entreprise, avec une équipe administrative consacrée à sa gestion. Notre directeur est arrivé début 2017, une responsable des ressources humaines en 2019 et un deuxième comptable en 2020 ».
Qui dit équipes élargies dit agrandissement des locaux. À Saint-Martin, toute l’équipe bénéficie désormais d’un établissement de 2 500 mètres carrés. « Ces locaux étaient prévus au début pour 70 personnes au maximum. Maintenant, nous sommes déjà 90 », indique Adeline Linsart.
Le frein du recrutement
Ce développement se heurte, comme dans tous les établissements vétérinaires de France, à des contraintes de recrutement, notamment de spécialistes. « Nous sommes en concurrence avec d’autres CHV. Aujourd’hui, ce sont les collaborateurs qui nous choisissent », confie Isabelle Testaut. « Le recrutement est notre principale difficulté, tous services confondus, et plus particulièrement celui des urgences. Il faut d’abord réussir à recruter, puis former et à garder nos collaborateurs. Il faut aussi pouvoir répondre aux nouvelles attentes légitimes des salariés, qui souhaitent un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Pour un CHV, c’est un vrai défi », témoigne Adeline Linsart. « Il y a une tension dans le recrutement du personnel d’urgence. C’est la contrainte la plus importante pour les structures qui voudraient obtenir le statut de CHV. C’est aussi un enjeu d’image, puisque le pôle des urgences est celui qui va potentiellement générer le plus d’insatisfaction de la part des clients », avance Antoine Dunié-Mérigot (T 03), spécialiste en chirurgie au CHV Languedocia, à Montpellier (Hérault). Pour les CHV pour animaux de compagnie, le cahier des charges impose une ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec au minimum deux professionnels qualifiés, dont un vétérinaire, et la capacité à mobiliser « à toute heure son plateau technique et ses équipes dans un temps compatible avec la prise en charge normale des urgences ». Le recrutement nécessaire pour assurer celles-ci, sans oublier le soin des animaux hospitalisés, est donc une condition sine qua non pour conserver ce statut. Et, plus globalement, pour faire perdurer le modèle. Car, outre les soins spécialisés, « c’est aussi sur les urgences que nos structures ont bâti nos modèles économiques. À une époque se posait la question de leur rentabilité. Avec le recul, on s’aperçoit qu’elles sont largement rentables, ou au moins génèrent-t-elle des nouveaux clients. Le service d’urgence n’est plus considéré comme une contrainte, c’est un réel secteur d’activité de la structure, moteur de son développement », souligne Éric Bomassi. OnlyVet, un CHV pour animaux de compagnie situé à Saint-Priest (Rhône), sort toutefois du lot en ayant opté pour un modèle différent (voir témoignage d’Alexis Lecoindre).
Former des spécialistes
Le dispositif des internships est un moyen d’alimenter le pôle des urgences, mais aussi de favoriser la formation des spécialistes. « Nous l’avons intégré cette année. Il nous permet de recruter des nouveaux talents pour les urgences, mais aussi des profils qui peuvent potentiellement prétendre à des postes de résidents. Cela nourrit nos structures afin de répondre à la demande croissante en spécialistes », explique Charlotte Barbé (N 30), praticienne en ophtalmologie au CHV Aquivet, à Eysines (Gironde). L’établissement est le premier et le seul CHV pour animaux de compagnie de Nouvelle-Aquitaine. Selon une étude menée en 2020 par l’association étudiante ProVéto Junior Conseil dans 12 CHV, il y avait cette année-là en moyenne trois résidents par structure. Les CHV Fregis, Advetia et Atlantia étaient les trois établissements qui en formaient le plus, avec respectivement 12, 6 et 6 résidents. Il avait été analysé que, depuis la création des CHV, ceux-ci avaient contribué à la formation de 66 spécialistes, dont 68 % par le CHV Fregis. Malgré tout, « la spécialisation a du retard en France, alors que les clients sont aujourd’hui demandeurs d’une médecine de pointe, a minima à hauteur de ce qui se fait pour l’humain, voire plus », affirme Éric Bomassi. « Il y a un changement de statut de l’animal, avec des attentes quelquefois démesurées par rapport aux moyens financiers et à ce qu’il est possible de proposer en médecine vétérinaire », relève Adeline Linsart.
L’intership fait toutefois face à une certaine concurrence, soutient Cyrill Poncet (T 98), spécialiste en chirurgie au CHV Fregis. « Ce n’est pas une formation diplômante à proprement parler, mais l’intership répond à la certification Qualiopi et suit les normes européennes de l’American Veterinary Medical Association et de l’European Board of Veterinary Specialisation. Nous avons construit un parcours de formation structuré de douze mois, avec un examen de fin d’année. C’est un dispositif gagnant-gagnant : les jeunes bénéficient d’une formation bien encadrée et reconnue pour sa qualité, et cela nous permet de faire tourner les CHV. Le problème est qu’en parallèle, des groupes de cliniques proposent désormais aussi des programmes de formation, mais sans aucun cadre construit ni reconnu, et sans suivi. Nous considérons cela comme mensonger vis-à-vis de jeunes diplômés. C’est un sujet que nous portons auprès de l’Ordre. »
Un enjeu de reconnaissance
Cyrill Poncet évoque un autre défi auquel les CHV doivent faire face. « Certains sont en crise car ils se retrouvent en concurrence frontale avec d’autres structures qui miment les CHV, sans les contraintes du cahier des charges : elles absorbent les urgences selon leur gré, mais dispensent surtout des soins spécialisés sans la présence de vétérinaires spécialistes. Cela peut représenter une concurrence énorme, qui peut aller jusqu’à remettre en cause la viabilité financière des CHV. » Une situation qui pose la question de la reconnaissance des CHV par les instances, d’autant qu’aux yeux du détenteur de l’animal, la différence entre ces structures et les CHV ne va pas de soi. « La concurrence est saine et profitable pour tous, à condition que chacun soit en mesure de s’imposer les quelques règles de bonne conduite que nos instances nous suggèrent. Cela permettrait à tous les établissements de se développer de manière différente et complémentaire. »
Il poursuit : « Si les CHV peuvent s’émouvoir d’un manque de soutien au sein de la profession et d’une concurrence parfois abusive, il existe peut-être certaines dérives à identifier à tous les niveaux. Une structure s’était en effet octroyée librement l’appellation de CHV sans pourtant répondre au cahier des charges. Ce statut a donc été supprimé après trois ans de procédure. Un CHV a lui perdu son titre au bout de quelques années car il ne respectait plus le cahier des charges ». « Nous sommes audités tous les trois ans par l’Ordre. Cette politique de contrôle devrait aussi s’appliquer aux autres structures, notamment celles qui affichent “urgences 24 heures sur 24” », précise Éric Bomassi.
Tous ces défis semblent moins marqués en pratique équine : pour les deux interviewés (voir témoignage et plus bas), la croissance se fait globalement sans embûches, sans grande difficulté de recrutement ni de gestion des urgences (voir témoignage de Matthieu Cousty). « Nous avons obtenu le statut de CHV en 2021. Cela s’est fait dans la continuité du développement de notre structure, et le statut n’a pas changé notre façon de travailler », relate Marianne Depecker (L 07), spécialiste en médecine interne des équidés au CHV équin de Conques, à Saint-Aubin-de-Branne (Gironde). Elle pointe toutefois un enjeu de reconnaissance pour sa clinique : « On espère que notre nouveau statut entraînera une meilleure reconnaissance de notre rôle dans la formation continue des jeunes diplômés, tout comme des résidents, et de la qualité de la formation dispensée dans un CHV par rapport à d’autres structures qui ne le sont pas. » D’après elle, le rôle majeur du CHV dans la formation continue est une suite logique dans le développement de ces établissements, étant donné qu’elles proposent des compétences spécialisées et du matériel de pointe. « Nous pourrions disposer de contrats adaptés pour celles et ceux qui suivent de telles formations, ce qui n’existe pas actuellement. »
« Pour l’avenir, il faut garder le cap, maintenir à niveau ce qui nous distingue en matière de permanence et de continuité des soins, et être irréprochables dans nos prises en charge », affirme Isabelle Testaut. Mais, dans la conjoncture actuelle, attention au faux pas : « Gare à une gestion approximative, à une expérience client dégradée ou à une masse salariale trop importante ! La structuration de l’entreprise, une bonne vision et une bonne facturation doivent être de mise. Les groupes, pour la plupart anglo-saxons ou nordiques, ont déjà cette expertise et aident en ce sens. S’adosser à un groupe facilite également les investissements lourds nécessaires à ce développement. » « Pouvoir offrir un panel d’offres de services de qualité et une réponse aux besoins techniques est notre levier d’expansion économique, selon Dimitri Leperlier. Mais cela implique de pouvoir assumer des contraintes financières importantes en matériel, en immobilier… ce qui n’est pas forcément possible tout seul, ni voulu. Dans cette optique, les groupes apparaissent comme un soutien bienvenu. » « Le groupe n’est pas un passage obligé mais, au-delà d’une certaine taille de structure, et compte tenu des risques individuels, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, il peut être nécessaire de s’appuyer sur des investisseurs supplémentaires. À un tel stade, piloter l’entreprise va au-delà de nos compétences vétérinaires, estime Éric Bomassi. Le modèle économique actuel des CHV reste toutefois bon et solide, et ce malgré la conjoncture ». Actuellement, seuls quatre CHV pour animaux de compagnie n’ont pas choisi, pour l’instant, d’intégrer un groupe, et aucun CHV équin ne l’a fait (à la date des interviews, NDLR).
« Cela aurait du sens d’avoir un CHV par bassin de drainage, soutient Adeline Linsart. En revanche, c’est une structure lourde à gérer, qui a des charges élevées, notamment salariales. Dans notre fonctionnement, nous sommes largement au-delà du cahier des charges imposé par l’Ordre. Il ne peut donc y en avoir un nombre non contrôlé, au risque de casser le modèle. Le maillage en CHV du territoire est sans doute une mission ordinale à mener. » Côté réglementation, le cadre est satisfaisant, mais Cyrill Poncet met en garde : « Dans certains pays, quelques interventions chirurgicales sont mieux prises en charge par les assurances quand elles sont réalisées par des vétérinaires spécialistes, car les assureurs ont pu identifier moins de complications postopératoires. Après plusieurs décennies de retard de la spécialisation en France, il n’est sans doute pas souhaitable que nous en arrivions à ce stade, mais cela devrait faire appel à une prise de conscience et à une responsabilité collective. Et si les mentalités ne savent pas évoluer, alors elles seront imposées. »
Alexis Lecoindre (Liège 09)
Spécialiste en médecine interne au CHV OnlyVet, à Saint-Priest (Rhône)

Un partenariat innovant
Avant d’être CHV, notre établissement, qui est né en 2019 d’une fusion de 2 clientèles, fonctionnait en activité référée exclusive. Mais au fur et à mesure de notre développement, associé à une prise en charge de cas de plus en plus complexes, nous nous sommes heurtés à la difficulté de la continuité des soins en dehors des heures d’ouverture de la structure. En parallèle, au vu de notre trajectoire de forte croissance, 12 personnes en 2019 et 75 en 2022, envisager la création d’un pôle d’urgences, et toutes les difficultés qui y sont associées, n’était pas sans risque pour la structure. De plus, l'activité d'urgence de nuit et de week-end nécessite la mise en place d'une équipe performante dès l'ouverture et le recrutement est souvent difficile. La solution nous est venue en établissant un partenariat avec une structure spécialisée, Vétérinaires 2 toute urgence. Les 2 entités sont situées dans les mêmes locaux. L’avantage de ce partenariat est que les équipes de V2TU ont un recul important sur de la gestion des urgences, ils sont aussi compétents en soins intensifs. De plus, les vétérinaires travaillant avec V2TU pour leurs urgences peuvent récupérer la gestion de leur patient dès l’ouverture de leur clinique s’ils ne souhaitent pas ou que le cas ne nécessite pas qu’il soit transféré dans nos services spécialisés. Cela permet aux vétérinaires travaillant avec nous de garder le contrôle tout au long de la prise en charge de l’animal dans les services du CHV Onlyvet. En parallèle, cette organisation nous permet de nous focaliser sur notre activité de référé et urgence de jour, qui est notre ADN. Le bilan de ce fonctionnement semble pour l’instant positif.
Charlotte Barbé (N 03)
Service d'ophtalmologie du CHV Aquivet, à Eysines (Gironde)
Développer l’offre de médecine spécialisée
C’est dans une optique de partenariat avec les praticiens de la région Nouvelle-Aquitaine qu’Aquivet s’est développé. Depuis sa création en 2006, notre modèle repose exclusivement sur des soins en référé. Nous avons acquis l’appellation de centre hospitalier vétérinaire (CHV) en 2020, après plusieurs années d’ouverture et d’évolution de notre service d’urgence, qui répondait à notre volonté d’aider nos vétérinaires référents dans la permanence et la continuité de soins pour les animaux pris en charge. Nos principaux enjeux sont de continuer à proposer des soins d’excellence et de diversifier l’offre en médecine spécialisée, en recrutant des spécialistes de différentes disciplines. Cette pratique multidisciplinaire est une vraie force : elle nous permet de prendre en charge de façon globale et complète un animal lorsque le vétérinaire référent le demande. L’accès à des soins spécialisés peut en outre être un avantage pour la gestion des urgences. Dans le cadre de notre croissance, il nous faut aussi répondre aux besoins d’évolution de la gestion administrative de notre structure. Notre équipe, forte de près de 90 salariés, compte ainsi des personnes qui y sont dévolues. Notre trajectoire, comme celle des autres CHV, est dictée par l’intérêt de la santé animale et par les demandes des propriétaires.
Matthieu Cousty (N 05)
Spécialiste en chirurgie équine au CHVE de Livet, à Saint-Michel-de-Livet (Calvados)
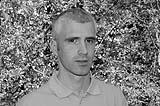
Nous choisissons librement notre stratégie
Par rapport aux centres hospitaliers vétérinaires (CHV) pour animaux de compagnie, notre structure équine conserve une part importante de consultations à l’extérieur, avec une clientèle propre, ce qui est courant dans ce milieu. Presque 50 % de nos vétérinaires travaillent en dehors de l’établissement, dans le cadre d’une activité généraliste.L’activité référée pour la permanence et la continuité des soins concerne essentiellement les urgences hospitalières. En matière de développement, notre CHV est indépendant et cela nous permet de choisir librement notre stratégie. Cela repose donc, comme pour de nombreuses structures, sur la mise en place de moyens humains et techniques en même temps que sur l’évolution de l’activité. Depuis l’obtention du statut de CHV équin (CHVE) en 2016, nous recrutons un ou deux vétérinaires par an. Côté matériel, nous étions équipés avant ce changement de titre, mais nous avons continué à investir pour améliorer notamment nos unités de soins intensifs et de néonatalogie. Hormis les difficultés propres à l’ensemble de la profession actuellement, nous n’en rencontrons pas particulièrement dans le recrutement des vétérinaires.
Le pôle des urgences a pris une ampleur considérable en dix ans, explique Antoine Dunié-Mérigot (T 03), spécialiste en chirurgie au centre hospitalier vétérinaire (CHV) Languedocia, à Montpellier (Hérault). « Notre constat est qu’il y a de moins en moins de structures vétérinaires qui prennent en charge les urgences. Dans ce contexte, notre CHV, qui a l’obligation d’être ouvert en permanence et de disposer des moyens adéquats pour gérer les urgences, arrive presque à saturation. Dans notre secteur, il n’existe plus que deux gros centres d’urgence dans un périmètre de 50 kilomètres. Cela nous a contraints à recruter du personnel : nous comptons désormais cinq vétérinaires présents sur site le dimanche, et deux pour les nuits. Il y a trois ans, trois vétérinaires les dimanches et un les nuits suffisaient. Et, même avec cette hausse d’effectifs, le nombre de consultations peut parfois dépasser nos capacités. » En outre, l’élargissement des équipes a un coût. « C’est le talon d’Achille des CHV, et ma crainte est que les services d’urgence ne soient plus assurés que par des très grands centres, qui concentrent un nombre important de cas, indique-t-il. Notre solution est de professionnaliser ces services avec des compétences spécifiques à cet exercice – nous avons un spécialiste en urgence et soins intensifs – et du matériel de pointe. Ce cadre de travail est motivant pour les équipes, va contrebalancer la sensation de surcharge de travail et fidéliser le personnel. » « Les urgences, c’est une contrainte, mais aussi la raison d’être d’un CHV. Étant donné les moyens engagés, nous avons besoin que nos confrères et consœurs nous fassent confiance. Il est toutefois difficile de pouvoir mettre en adéquation le personnel disponible par rapport au volume des urgences. C’est une hérésie de se dire que celles-ci ne seraient traitées que par les CHV, tout comme c’est illogique de fonctionner chacun dans son coin. C’est un équilibre à trouver », résume Adeline Linsart (N 04), praticienne exclusive en médecine des nouveaux animaux de compagnie au CHV Saint-Martin, à Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie).